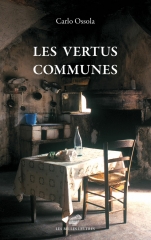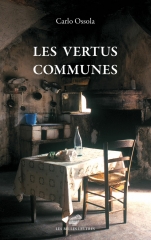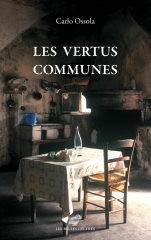 L’été a déjà bien ralenti le rythme des blogs et/ou des commentaires. Comme chaque année, la belle saison nous appelle au plein air, à la détente, aux rencontres : « Aller, venir, ouvrir nos yeux, nos oreilles, rêver… » (Plumes d’anges). Quoi qu’il en soit, les billets d’été comme ceux d’hiver restent disponibles en ligne et trouvent parfois de nouveaux lecteurs occasionnels, en plus de fournir à celles ou ceux qui les ont rédigés une mémoire externe facile à consulter pour rafraîchir ses souvenirs, n’est-ce pas ?
L’été a déjà bien ralenti le rythme des blogs et/ou des commentaires. Comme chaque année, la belle saison nous appelle au plein air, à la détente, aux rencontres : « Aller, venir, ouvrir nos yeux, nos oreilles, rêver… » (Plumes d’anges). Quoi qu’il en soit, les billets d’été comme ceux d’hiver restent disponibles en ligne et trouvent parfois de nouveaux lecteurs occasionnels, en plus de fournir à celles ou ceux qui les ont rédigés une mémoire externe facile à consulter pour rafraîchir ses souvenirs, n’est-ce pas ?
Avant de refermer pour de bon l’essai de Carlo Ossola divisé en douze chapitres, soit « douze stations pour devenir un peu plus humains » (titre de l’introduction), voici deux vertus encore. Après l’affabilité, la discrétion, la bonhomie, la franchise, la loyauté, la gratitude, la prévenance, l’urbanité, la mesure et la placidité, place à la constance et à la générosité.
La constance
XI. « La constance que je préfère est la roue du potier*, le tour que font les mulets autour de la meule, le balancement des bras qui fauchent l’herbe, la cantilène pareille à une ritournelle, le charretier en route : « Et en chantant, sur une triste mélodie, / Le charretier salue la dernière blancheur / De la lueur fuyante / Qui l’avait guidé, chemin faisant » (Leopardi, Le Coucher de la lune) ; tout ce qui, à une cadence silencieuse, assure la durée de l’être humain ; nihil novi sub sole, notre seule éternité. »
Carlo Ossola, Les vertus communes
* allusion à une réflexion d'Italo Calvino citée juste avant (dans une lettre à Primo Levi)
La générosité
XII. « Mais il existe un personnage qui réunit en soi toutes les générosités, et bon nombre des petites vertus que nous avons examinées jusqu’à présent (de la bonhomie à la prévenance, de l’affabilité à la constance), c’est Geppetto dans Pinocchio de Carlo Collodi. »
 Carlo Ossola l’explique en quelques pages à la fin des Vertus communes (2019). Dans ce petit volume dont j’ai partagé ici des bribes apéritives, les auteurs latins et italiens abondent, mais il y en a beaucoup d’autres.
Carlo Ossola l’explique en quelques pages à la fin des Vertus communes (2019). Dans ce petit volume dont j’ai partagé ici des bribes apéritives, les auteurs latins et italiens abondent, mais il y en a beaucoup d’autres.
Ce dernier chapitre, par exemple, s’achève sur des paroles de chanson, The Stranger Song de Leonard Cohen, et un film, John McCabe, « scandé par ce refrain ».
Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de réagir ici aux propositions de cet essai intéressant. Avis aux amateurs : je découvre un peu tard sur le site des Belles Lettres que Carlo Ossola a repris et complété son sujet en 2023 dans La Vie simple, Les vertus minimes et communes : douze vertus « pour soi » et douze vertus « pour les autres ». Parmi celles-ci, l’extrait à lire en ligne porte sur le tact et l’ironie.